Forces et failles de la gestion des déchets : bilan et pistes d’amélioration
| Le blog d'AnimalWeb |
| Le blog des chats |
| Le blog des chiens |
| Le blog des animaux |
| Chasse et maltraitance |
| Environnement |
| Infos et bons plans |
| Etre Végan |
| Les histoires |
| Actualités |

Face à l’augmentation constante de la population et à un mode de consommation toujours plus intense, la gestion des déchets est devenue un enjeu crucial. En France comme en Belgique, de nombreux progrès ont été réalisés : tri sélectif, recyclage des PMC, recyparcs, points d’apport volontaire… autant d’initiatives qui témoignent d’une volonté collective de réduire notre impact environnemental. Pourtant, derrière ces avancées se cachent encore des failles : contraintes pour les citoyens, coûts mal perçus, incivilités, limites des infrastructures. Cet exposé dresse un état des lieux des forces et des faiblesses du système actuel, tout en proposant des pistes d’amélioration concrètes pour un traitement des déchets plus efficace, plus équitable et plus respectueux de la nature.
Progrès et limites actuelles de la gestion des déchets
Au cours du XXIᵉ siècle, la gestion des déchets en France et en Belgique a connu des avancées majeures. Ces progrès sont essentiels face à l’augmentation continue de la population et à l’évolution rapide des modes de consommation. Les décharges à ciel ouvert, comme celle autrefois située à Mont-Saint-Guibert, font désormais partie de l’histoire... du moins, espérons-le.
Les innovations techniques, telles que le recyclage des PMC (plastiques, métaux, cartons à boissons), des cartons, des batteries ou encore des pneus, permettent aux fabricants de réutiliser les matières premières issues des déchets et de réduire notre empreinte écologique.
Pour participer activement à ce processus, les citoyens disposent aujourd’hui de nombreux outils : sacs PMC, sacs organiques, sacs résiduels, bulles à verre, conteneurs à vêtements, points d’apport volontaire, recyparcs, collectes d’encombrants et plateformes privées pour revendre ou échanger des objets. Cette diversité renforce notre capacité à trier et recycler efficacement les déchets.
Cependant, aucun système n’est parfait. Des améliorations restent nécessaires pour faciliter le tri sélectif, optimiser le travail des agents communaux et régionaux, et lutter contre les dépôts sauvages. Dans la suite de cet exposé, nous analyserons point par point les différents systèmes de collecte et de recyclage, en mettant en lumière leurs forces, leurs faiblesses et les pistes d’amélioration les plus pertinentes.

Analyse des défis et pistes d’amélioration du système de collecte et de recyclage
La France et la Belgique disposent d’un système complet de collecte et de recyclage des déchets, allant du tri sélectif aux recyparcs en passant par la collecte porte-à-porte. Pourtant, ce dispositif présente encore des contraintes, incohérences et zones d’ombre qui peuvent freiner son efficacité et décourager les citoyens.
Tour d’horizon des principaux points à améliorer, avec des solutions concrètes et réalistes.
Gestion des déchets multiples : nécessité ou contrainte excessive ?
La multiplication des sacs, conteneurs et catégories de tri a indéniablement permis un traitement plus précis des déchets et une meilleure valorisation des matières recyclables. Les sacs PMC, sacs organiques, sacs résiduels, containers à papier-carton ou encore collectes spécifiques pour les déchets verts contribuent à limiter la quantité de déchets envoyés à l’incinération. Cependant, cette organisation, aussi vertueuse soit-elle, peut rapidement devenir une contrainte disproportionnée pour les citoyens si elle n’est pas pensée de manière pragmatique.
Un exemple fréquemment cité est celui de la collecte des sacs résiduels toutes les deux semaines, y compris en période estivale. En plein été, la chaleur accélère la décomposition des matières organiques, provoquant de fortes odeurs et favorisant l’apparition d’asticots. Cette situation peut être particulièrement problématique dans les immeubles à appartements, les petites habitations sans jardin ou les logements où l’espace de stockage est limité.
La question de la fréquence de collecte mérite donc d’être adaptée aux réalités locales. Dans les zones urbaines denses ou lors des périodes chaudes, un passage hebdomadaire pourrait être maintenu afin de préserver la salubrité publique et éviter que les sacs ne s’accumulent. À l’inverse, dans certaines zones rurales où la production de déchets résiduels est moindre, un rythme plus espacé peut rester pertinent.
Solutions envisagées
Mettre en place un calendrier de collecte flexible et saisonnier, différencié selon les caractéristiques démographiques et géographiques des communes. De plus, informer clairement les citoyens sur les raisons et avantages de ces choix renforcerait leur adhésion. Car un système de tri perçu comme trop rigide ou inadapté risque de produire l’effet inverse à celui recherché : hausse des dépôts sauvages, incivilités et perte de confiance dans les autorités locales.
Le “coût vérité” : une taxe écologique équitable ?
Le principe du “coût vérité” repose sur une idée simple : faire payer au citoyen le coût réel de la collecte et du traitement de ses déchets, afin de responsabiliser chacun et de réduire la production de déchets non recyclables. Sur le papier, ce système semble juste et écologique. Dans la réalité, il suscite des débats, car il peut pénaliser autant les citoyens exemplaires que ceux qui ne respectent pas les règles du tri.
Ces dernières années, la hausse des taxes communales liées aux déchets, le prix croissant des sacs poubelles officiels ou encore l’introduction annoncée d’une consigne sur les canettes alimentent le mécontentement. Si la consigne fonctionne bien dans certains pays, elle peut devenir contraignante pour une partie de la population : obligation de stocker les emballages, de les rincer, puis de les rapporter dans un point de collecte, ce qui peut décourager des citoyens qui trient déjà correctement. De plus, elle ne prend pas en compte les achats effectués à l’étranger ou en Flandre, créant une inégalité d’application et un risque de contournement.
Une autre critique récurrente concerne la transparence : les citoyens acceptent plus facilement un effort financier lorsqu’ils savent clairement comment l’argent est utilisé. Or, peu d’informations sont communiquées sur l’affectation précise des recettes issues des sacs poubelles, des taxes ou des consignes. Cet opacité nourrit la méfiance et l’impression que ces mesures servent davantage à remplir les caisses de l'état qu’à protéger l’environnement.
Axes d’évolution
-
Garantir une transparence totale sur l’utilisation des fonds (par exemple, indiquer chaque année le pourcentage réellement investi dans la prévention, le recyclage et la modernisation des infrastructures).
-
Mettre en place un système incitatif qui récompense les bons trieurs plutôt que de leur imposer les mêmes contraintes qu’aux mauvais trieurs (réductions, primes ou points convertibles en services communaux).
-
Adapter les mesures pour éviter les effets pervers, comme les dépôts sauvages ou les achats massifs hors de la zone concernée.
En résumé, le “coût vérité” peut être un levier efficace de gestion des déchets, mais uniquement s’il est appliqué avec équité, clarté et cohérence, tout en valorisant les efforts des citoyens déjà engagés dans le tri sélectif.
Limites des incinérateurs face à l’augmentation des déchets
Les incinérateurs occupent une place centrale dans la gestion des déchets non recyclables en Belgique. Ils permettent de réduire le volume des déchets, de limiter l’enfouissement et, dans certains cas, de produire de l’énergie grâce à la valorisation énergétique. Toutefois, leur rôle reste limité par deux contraintes majeures : leur capacité et leur acceptabilité sociale.
Avec l’augmentation de la population et l’évolution des modes de consommation, la quantité de déchets à traiter ne cesse de croître. Les incinérateurs existants fonctionnent souvent à pleine capacité, ce qui oblige parfois à transporter des déchets vers d’autres régions ou pays, avec un coût environnemental et financier supplémentaire. Construire de nouvelles unités pourrait sembler une solution, mais cela implique des investissements considérables, des délais longs, et une opposition fréquente des riverains, qui craignent les impacts sur la santé et l’environnement.
En parallèle, même si les incinérateurs modernes sont équipés de filtres et respectent des normes strictes, ils restent émetteurs de gaz à effet de serre et de particules fines. Miser uniquement sur cette technologie reviendrait à traiter les symptômes plutôt qu’à s’attaquer à la source du problème.
Propositions d’optimisation
-
Renforcer la prévention en amont pour réduire le volume de déchets résiduels : éducation au tri, limitation des emballages inutiles, promotion du réemploi.
-
Investir dans des alternatives complémentaires comme la méthanisation (pour les déchets organiques) ou le compostage industriel, afin de détourner une partie des flux entrants vers des filières moins polluantes.
-
Optimiser la valorisation énergétique des incinérateurs existants pour produire davantage d’électricité ou de chaleur, tout en améliorant encore le traitement des fumées.
En résumé, les incinérateurs resteront un maillon important de la chaîne de gestion des déchets, mais leur rôle doit être pensé dans un ensemble plus large où la réduction à la source et la diversification des méthodes de traitement deviennent prioritaires.
Recyparcs : un outil performant mais perfectible
Les recyparcs constituent aujourd’hui un pilier incontournable dans la gestion des déchets. Ils offrent aux citoyens un espace dédié où déposer une grande variété de matériaux (du bois aux métaux, en passant par les appareils électriques et les déchets verts) afin qu’ils soient correctement triés et dirigés vers les filières de recyclage adaptées. Grâce à leur rôle central, ils contribuent significativement à la réduction des volumes envoyés en décharge ou à l’incinération, et favorisent une économie circulaire plus responsable.
Cependant, malgré ces points forts, les recyparcs souffrent de plusieurs limites qui freinent leur potentiel et peuvent décourager certains usagers. Parmi les principales critiques, on note des horaires d’ouverture parfois trop restreints, qui ne correspondent pas toujours aux rythmes de vie actuels, notamment pour les personnes qui travaillent en journée. L’accès physique à ces infrastructures peut aussi poser problème : certaines zones rurales ou quartiers mal desservis disposent de peu de recyparcs proches, ce qui complique le dépôt régulier des déchets encombrants ou spécifiques. De plus, l’absence d’unités mobiles (camions équipés pouvant collecter directement chez les habitants) limite la flexibilité du système et l’inclusion des populations moins mobiles ou éloignées.
Perspectives d’amélioration
Pour répondre à ces enjeux, plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées. D’abord, élargir les horaires d’ouverture, en proposant notamment des plages en soirée et le samedi, afin d’augmenter la disponibilité pour tous les citoyens. Ensuite, développer un service mobile de collecte, qui se déplacerait dans les villages et quartiers périurbains, facilitant ainsi le dépôt et limitant les déplacements en voiture, source de pollution. Enfin, il est essentiel de renforcer la communication sur les services offerts par les recyparcs, mais aussi sur l’importance du tri et du recyclage, afin de sensibiliser davantage la population à ces pratiques écologiques.
Ainsi, en rendant les recyparcs plus accessibles, mieux adaptés aux besoins et mieux intégrés dans la vie quotidienne, ils pourraient devenir non seulement un lieu de dépôt, mais aussi un véritable levier éducatif et un symbole fort de la transition écologique locale.
Bulles à verres, containers à vêtements et points d’apport volontaire : un potentiel sous-exploité
Les bulles à verres, containers à vêtements et autres points d’apport volontaire sont des infrastructures de proximité précieuses pour encourager le tri et la réutilisation. Ils permettent aux citoyens de se débarrasser facilement de certains déchets spécifiques tout en participant activement à la réduction des volumes envoyés en décharge ou en incinération. Ces dispositifs, bien implantés dans les quartiers, sont souvent une première étape simple et accessible vers une gestion responsable des déchets.
Cependant, leur gestion opérationnelle laisse parfois à désirer, ce qui nuit à leur efficacité et à leur image. L’un des problèmes fréquents est la nature du sol sur lequel ces points sont installés. Lorsque celui-ci est en gravier ou en terre, il devient quasiment impossible de nettoyer efficacement en cas de sacs déchirés ou de déchets dispersés. Ce manque d’entretien favorise l’accumulation de saletés et d’odeurs, ce qui peut rapidement dégrader l’environnement et encourager d’autres dépôts sauvages, renforçant un cercle vicieux. De plus, le suivi et le contrôle réguliers de ces espaces sont souvent insuffisants, ce qui accroît encore les risques d’incivilités.
Un autre défi concerne le remplissage excessif de ces points d’apport, notamment lors des périodes de forte affluence comme les fêtes de fin d’année. Une fois saturés, bulles à verre ou containers à vêtements ne peuvent plus accueillir de nouveaux dépôts, ce qui pousse certains usagers à abandonner bouteilles, vêtements ou sacs poubelles à proximité immédiate. Ces dépôts sauvages nuisent à la propreté des lieux et traduisent parfois un relâchement des efforts citoyens de tri.
Stratégies à explorer
Pour améliorer cette situation, plusieurs pistes sont envisageables. D’abord, privilégier systématiquement un sol en béton ou en matériaux faciles à nettoyer pour toutes les nouvelles implantations ou lors de rénovations. Cette simple mesure faciliterait grandement le maintien de la propreté et la gestion des éventuels déchets égarés. Ensuite, renforcer les contrôles et les interventions de nettoyage afin de garantir un état irréprochable en permanence, signalant ainsi aux usagers que ces lieux sont surveillés et respectés. Par ailleurs, intégrer ces points d’apport volontaire dans des zones fréquentées et bien éclairées (à proximité de commerces, écoles ou lieux publics) permettrait de dissuader les dépôts sauvages, car la visibilité agit souvent comme un frein aux comportements inciviques.
Enfin, pour répondre au problème du remplissage rapide, il serait utile de mettre en place un système de signalisation simple permettant aux citoyens d’alerter le gestionnaire dès qu’un point est plein. Par ailleurs, adapter la fréquence de collecte en fonction des périodes de forte affluence, avec des rotations renforcées notamment lors des fêtes, améliorerait grandement la disponibilité des points d’apport. À terme, l’installation de capteurs connectés, par exemple à infrarouge, pourrait permettre un suivi en temps réel du taux de remplissage, optimisant ainsi la planification des interventions et évitant les débordements.
En somme, en optimisant la gestion, l’implantation et la surveillance des bulles à verres, containers à vêtements et autres points d’apport, on peut non seulement améliorer l’efficacité du tri, mais aussi préserver la propreté et la qualité de vie dans nos quartiers.
Enlèvement des encombrants : un service utile mais à encadrer
L’enlèvement des encombrants constitue un service indispensable, notamment pour les personnes qui ne disposent pas de véhicule ou de remorque pour transporter leurs objets volumineux vers les recyparcs ou points de collecte. Ce service facilite le bon déroulement du tri et prévient l’accumulation de déchets encombrants sur la voie publique, contribuant ainsi à la propreté urbaine et à la sécurité sanitaire.
Cependant, ce dispositif, s’il n’est pas bien encadré, peut facilement être détourné et engendrer des abus. Certains usagers profitent d’un accès libre et sans limite pour se débarrasser de quantités excessives d’objets, parfois non triés ou non éligibles, ce qui augmente les coûts pour les communes et surcharge les filières de traitement. Cette situation peut également générer des dépôts sauvages ou des déchets mal orientés, compromettant l’efficacité globale de la gestion des déchets.
Actions à considérer
Pour limiter ces dérives, plusieurs mesures réalistes et équilibrées peuvent être envisagées. Il est primordial d’imposer un tri préalable rigoureux afin que seuls les objets appropriés soient collectés, ce qui facilite leur valorisation et réduit les volumes à traiter. Par ailleurs, limiter le nombre d’enlèvements gratuits par foyer sur une base annuelle pourrait encourager un usage plus responsable de ce service, tout en évitant que certains en profitent de manière excessive.
Enfin, encourager la réutilisation des encombrants via des ressourceries ou des structures de réparation locale représente une solution à double bénéfice : elle prolonge la vie des objets, réduit la production de déchets et favorise une économie circulaire locale. Pour cela, il serait utile de mieux informer les citoyens sur ces alternatives, et d’intégrer ces acteurs dans la chaîne de gestion des encombrants, avec un soutien logistique et financier adapté.
Ainsi, en conciliant accessibilité, responsabilité et promotion de la réutilisation, l’enlèvement des encombrants peut rester un service vital, efficient et respectueux de l’environnement.
Collecte porte-à-porte : règles simples pour un service efficace
La collecte des déchets ménagers directement à domicile constitue le socle fondamental d’un système de gestion des déchets performant et d’une bonne sécurité sanitaire. En garantissant que les déchets sont évacués régulièrement et de manière hygiénique, elle limite les risques de nuisances, de prolifération d’insectes ou de maladies, tout en assurant un cadre de vie sain pour tous.
Cependant, la réussite de ce service repose sur la collaboration active des citoyens qui doivent respecter un ensemble de consignes simples mais indispensables : bien fermer les sacs pour éviter les fuites et dispersions, placer les containers de manière ordonnée et accessible (avec la poignée tournée vers la rue pour faciliter la prise par les agents), et surtout respecter les horaires de collecte pour éviter les accumulations.
Malheureusement, un certain non-respect de ces règles peut ralentir le travail des équipes de collecte, augmenter les risques d’incidents et, à terme, nuire à la qualité globale du service. Pour prévenir ces dérives, il est essentiel de renforcer la communication et la pédagogie autour de ces gestes simples.
Pistes d’amélioration
Une information claire et régulière, par le biais de campagnes de sensibilisation, d’affichages dans les quartiers, ou via les médias locaux, peut aider à rappeler l’importance de ces bonnes pratiques. Par ailleurs, un système d’avertissements progressifs avant sanction pourrait encourager la responsabilisation sans brusquer les usagers, en leur laissant la possibilité de corriger leurs erreurs.
Enfin, il serait utile d’impliquer davantage les citoyens dans la conception et l’adaptation des règles de collecte, en tenant compte des particularités locales (zones urbaines vs rurales, périodes de forte chaleur, événements spéciaux) pour optimiser la fréquence et les modalités du ramassage.
Ainsi, par un partenariat clair entre autorités, collecteurs et habitants, la collecte porte-à-porte peut rester un pilier efficace, accessible et respectueux de l’environnement.
Associations de réparation : un levier contre l’obsolescence programmée
Face à l’augmentation constante des déchets électroniques et ménagers, les associations de réparation jouent un rôle crucial pour prolonger la durée de vie des objets du quotidien. Ces initiatives citoyennes permettent non seulement de réduire significativement la quantité de déchets produits, mais aussi de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’obsolescence programmée, un phénomène qui pousse artificiellement à remplacer des appareils qui pourrait être encore fonctionnels.
Ces ateliers collaboratifs, souvent animés par des bénévoles passionnés, offrent un espace où chacun peut apprendre à réparer ses appareils, échanger des conseils, et redonner une seconde vie à des objets délaissés. Ils favorisent également la cohésion sociale en créant du lien entre les participants, tout en participant à une économie circulaire plus respectueuse de l’environnement.
Cependant, ces associations souffrent fréquemment d’un manque de ressources matérielles, logistiques et financières. Leur capacité d’action est ainsi limitée, ce qui freine leur développement et leur impact potentiel.
Solutions à approfondir
Pour maximiser leur contribution, un soutien public et privé serait essentiel : mise à disposition de locaux adaptés, financement ou prêt de matériel spécialisé, appui logistique pour mieux organiser les ateliers, et campagnes de communication pour accroître la visibilité et attirer un plus large public.
Une politique volontariste en faveur de ces acteurs locaux pourrait transformer la réparation en véritable réflexe citoyen, réduisant ainsi les déchets et encourageant une consommation plus responsable.
Lutte contre les incivilités : prévention ou sanctions ?
Les dépôts sauvages et autres comportements irrespectueux envers les règles de gestion des déchets restent un défi majeur pour les collectivités. Ces incivilités nuisent à la propreté des espaces publics, dégradent l’environnement, et engendrent des coûts supplémentaires pour leur nettoyage.
Les amendes, bien que dissuasives sur le papier, perdent souvent de leur efficacité lorsqu’elles ne sont pas systématiquement appliquées ou lorsqu’elles restent trop faibles pour décourager les récidivistes. De plus, une sanction purement financière peut parfois être perçue comme injuste, notamment quand elle frappe des personnes en situation de précarité.
Initiatives à privilégier
Pour améliorer la gestion de ces comportements, une approche plus équilibrée entre prévention et sanction pourrait être envisagée. Parmi les pistes, les travaux d’intérêt général représentent une alternative intéressante : ils permettent aux contrevenants de prendre conscience de leur impact en participant concrètement à l’entretien et à la remise en état des lieux pollués. Cette visibilité publique agit comme un levier de responsabilisation sociale, car la communauté peut voir l’engagement des contrevenants à réparer leurs torts.
Parallèlement, renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation à la propreté, dès le plus jeune âge, est essentiel pour créer une culture du respect de l’environnement et des règles de tri.
Enfin, il est nécessaire de garantir une application rigoureuse et transparente des sanctions, qu’elles soient financières ou alternatives, afin d’instaurer une véritable équité et de renforcer la confiance des citoyens dans le système de gestion des déchets.
Trop d’acteurs pour une même mission ?
La gestion des déchets mobilise aujourd’hui une multitude d’acteurs à différents niveaux : communal, intercommunal, régional, parfois même sectoriel. Si cette pluralité peut favoriser une certaine spécialisation, elle engendre aussi des lourdeurs administratives importantes, des chevauchements de compétences et surtout des coûts supplémentaires.
La multiplication des comités, présidences et instances de décision peut diluer la responsabilité, compliquer la coordination des actions, et rendre difficile une vision claire pour les citoyens. Ces redondances nuisent à l’efficacité globale du système et peuvent freiner la mise en place rapide d’améliorations concrètes.
Voies d’optimisation
Face à cette situation, une rationalisation des structures et des postes serait bienvenue. Réduire le nombre d’instances dirigeantes, fusionner certaines fonctions et simplifier les circuits décisionnels permettraient de réaliser des économies substantielles. Ces économies pourraient être directement réinvesties dans la collecte et le traitement des déchets, en améliorant la qualité du service offert aux habitants.
Par ailleurs, une plus grande transparence dans l’utilisation des budgets alloués renforcerait la confiance des citoyens envers ces institutions et leur politique environnementale. Elle favoriserait aussi une meilleure responsabilisation des acteurs publics.
En résumé, simplifier les structures de gouvernance de la gestion des déchets est un levier important pour gagner en efficacité, réduire les coûts, et améliorer la satisfaction des usagers.

Analyse des défis et pistes d’amélioration du système de collecte et de recyclage
Le système actuel de collecte et de recyclage des déchets en France et en Belgique constitue une base solide pour la gestion durable des ressources. Cependant, comme nous l’avons vu, il reste confronté à plusieurs défis majeurs : complexité du tri, équilibre délicat du “coût vérité”, limites techniques et sociales des incinérateurs, accessibilité des recyparcs, gestion des points d’apport volontaire, encadrement de l’enlèvement des encombrants et respect des règles de collecte porte-à-porte.
Ces défis ne sont pas insurmontables. Ils appellent avant tout une adaptation pragmatique des services aux réalités locales et aux besoins des citoyens, une transparence accrue dans la gestion financière et une valorisation des comportements vertueux. Plus encore, ils imposent une vision globale et coordonnée qui intègre la prévention, la réduction à la source, la diversification des modes de traitement et l’éducation environnementale.
L’amélioration du système passe donc par un dialogue constant entre autorités locales, professionnels du secteur et usagers, pour construire un modèle efficace, juste et durable. Car la réussite d’une gestion responsable des déchets repose avant tout sur l’engagement collectif, dans lequel chaque citoyen trouve sa place et sa motivation.
Ainsi, renforcer et simplifier les dispositifs, tout en valorisant l’effort citoyen et en investissant dans des technologies innovantes et respectueuses de l’environnement, est la voie pour relever les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés aux déchets.
Le défi est à la hauteur des enjeux, mais la transition écologique ne peut se faire sans une gestion optimisée et adaptée de nos déchets.
Ils sont perdus

WLG - Akira — Chat perdu à Liège — 11/02/2026
- Sexe Femelle
- Couleurs Gris, beige
- Type de pelage Gris tacheté
- Comportement Craintive
- Castré/stérilisé Oui
- Puce électronique 697679

WLG - Apolina — Chien perdu à OCHAIN — 06/02/2026
- Sexe Femelle
- Couleurs Brun
- Type de pelage Court
- Comportement Sociable

WHT - Poupousse — Chat perdu à Haine st paul — 19/01/2026
- Sexe Femelle
- Couleurs Noir et roux
- Type de pelage Ecaille de tortue
- Comportement Caline
- Castré/stérilisé Oui
- Puce électronique 421252
- Tatouage Oui
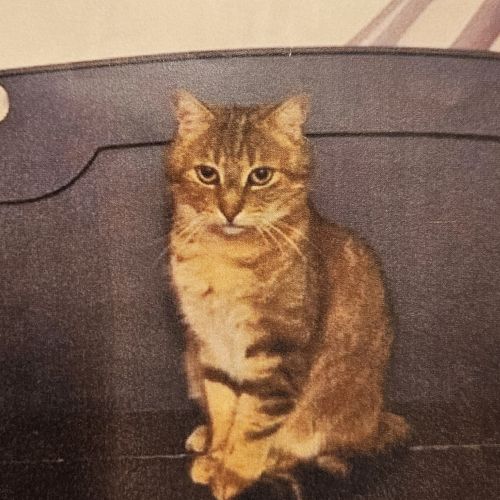
WNA - Papuch — Chat perdu à Yvoir — 16/01/2026
- Sexe Mâle
- Couleurs Tigré et roux
- Type de pelage Poils courts
- Comportement Gentil mais craintif
- Castré/stérilisé Oui
- Puce électronique 002207
Ils ont été trouvés

Chat trouvé à Mons — 07/01/2026
- Sexe Femelle
- Type de pelage Court
- Puce électronique Oui non enregistré

Chat trouvé à Herstal — 14/11/2025
- Sexe Mâle
- Couleurs Blanc et roux
- Type de pelage Tacheté
- Comportement Sociable et gourmand
- Castré/stérilisé Non

Chat trouvé à Ixelles — 25/09/2025
- Sexe Mâle
- Couleurs Gris tigre
- Castré/stérilisé Oui
- Puce électronique Non

Chat trouvé à Ruisbroek — 04/10/2025
- Sexe Mâle
- Type de pelage Tigré
- Castré/stérilisé Non
- Puce électronique Non

